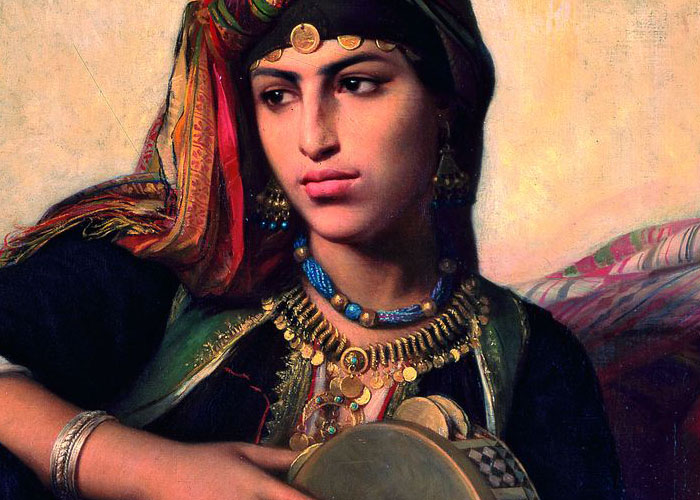Glossaire
Acrostiche
Bijou monté avec différentes pierres dont l’ordre est choisi de façon à ce que la succession des premières lettres de leur nom forme un prénom ou une phrase. Par exemple, pour « Napoléon » : N (niccolo) A (améthyste) P (péridot) O (opale) L (lapis) É (émeraude) O (opale) N (niccolo). Ce type de bijou a été très en faveur sous l’Empire.
Agate
Pierre appartenant à la catégorie des calcédoines mais qu’on assimile généralement aux onyx. La gravure fait apparaître les couches successives dont la pierre est constituée agate à une, deux ou trois couches de couleurs différentes.
Agneau mystique
Symbole chrétien figurant un agneau tenant une croix et une bannière. Apparu aux premiers siècles de notre ère, il figure souvent dans les peintures et les gravures du xvie et du xviie siècle.
Agnus Dei
Voir à Agneau mystique.
Aiguillette
Cordon servant à nouer et à lacer, terminé à chaque extrémité par un embout métallique appelé ferret.
Amatir, amati
Rendre mat un métal en en ôtant le poli. En orfèvrerie, l’amati est un type de ciselure consistant à cribler le métal de points ou de minuscules ronds à l’aide d’un poinçon (mat ou matoir).
Amulette
Petit objet de toute sorte que l’on porte sur soi et auquel on prête des vertus protectrices ou magiques. Les cornes et les mains en corail sont des exemples courants d’amulettes. Aux xviiie et xixe siècles, on agrémentait les chaînes de montre et les châtelaines de ces porte-bonheur.
Arabesque
Ornement composé de la répétition symétrique de motifs végétaux généralement stylisés (guirlandes de fleurs, ramures, palmettes, volutes, rinceaux…) et de divers autres motifs (rubans entrelacés…)
Ardillon
Pointe articulée métallique fixée sur la boucle d’une lanière, d’une ceinture, d’une sangle, d’une courroie… Insérée dans l’un de ses trous, elle ajuste le serrage et assure la fermeture de cet objet.
Argenture
Voir à Dorure.
Argent doré
Voir à Vermeil.
Bague marquise
Bague à chaton oblong ovale pointu. La bague marquise est devenue à la mode au xviiie siècle, alors qu’un afflux de pierres précieuses favorisait le développement des bagues à entourage.
Bague-tombeau
Bague dont le chaton reproduit un cercueil sur lequel sont incrustées des larmes d’émail noir.
Bélière
Anneau de forme ronde ou ovale auquel on suspend un bijou ou une montre et dans lequel on fait passer une chaîne.
Bijouterie
Terme utilisé pour désigner la fabrication des bijoux en or, en argent ou en tout autre métal décoré ou émaillé. Au xixe siècle, une série de nouvelles techniques a révolutionné la bijouterie.
Boîte de montre, boîtier
Voir à Montre.
Boucles et pendants d’oreilles
Créole : anneau d’oreille rond ou aplati, en forme de nacelle ou de croissant, qui traverse le lobe de l’oreille. Portées dès l’Antiquité, les créoles furent mises à la mode à la fin du xviiie siècle avec la robe-chemise venue des Antilles.
Dormeuse : boucle d’oreille articulée suffisamment petite pour être gardée la nuit.
Girandole : pendant d’oreille composé d’un motif central auquel sont attachées trois pendeloques (fin du xviie siècle).
Poissarde : anneau ovale présentant en façade un décor : motif ou séquence de motifs, perles, pierres. Les poissardes sont souvent renforcées par une entretoise en esse. On attribue le nom de ces boucles d’oreilles caractéristiques du Directoire à celui donné alors aux marchandes des halles : porter de lourds bijoux témoignait de leur réussite. À la mode sous l’Empire, elles furent adoptées comme bijou traditionnel dans plusieurs régions de France au cours du xixe siècle.
Bouton
Les boutons peuvent être « à trous » ou « à queue ». Ces derniers comportent trois parties : sur le dessus, la coquille, en dessous, le culot, et pour les attacher, la queue. Les boutons fonctionnels à trous ne se rencontrent, pour l’essentiel, qu’à partir du milieu du xixe siècle. Les boutons à queue peuvent être très décorés : à fond plein ou repercés, ils sont confectionnés dans des matériaux divers et peuvent emprunter à la bijouterie des techniques comme l’estampage et l’émaillage.
Breloquet
Ensemble de petits objets comme des cachets, des clés de montres, portés par les hommes à l’extrémité d’une chaîne et mis en évidence sur le gilet.
Cabochon
En joaillerie, gemme qui n’est pas taillée à facettes, mais simplement polie en dôme.
Camée
Pierre dure (agate) gravée en relief à deux ou trois couches. La partie sombre sert de fond, les parties plus claires sont utilisées pour les figures. On trouve également des camées gravés sur pierre fine, sur corail ou sur pierre de lave. Les camées et intailles étaient très appréciés des Grecs et des Romains. Ils redeviennent à la mode à l'époque néo-classique après une période d’oubli.
Camée coquille ou camée sur coquille
Camée gravé sur un coquillage. Les premiers camées sur coquille furent gravés à la Renaissance. Le coquillage utilisé au xixe siècle était le casque de Madagascar, plus facile à travailler que les pierres dures. Les camées sur coquillages étaient de surcroît moins onéreux. Voir à Camée.
Cannetille
Fil métallique auquel on a donné une forme de ressort en l’enroulant en spirale serrée autour d’une tige. C’est une forme particulière du filigrane. La cannetille a été largement utilisée dans le décor des bijoux à partir de la Restauration, avec le grènetis.
Chagrin
Variété de cuir à surface grenue utilisée en reliure et en maroquinerie de luxe ; à l’origine, il était préparé avec de la peau de croupe de mulet, d’âne ou de cheval. Ce terme désigne aujourd’hui un cuir de chèvre ou de mouton de qualité inférieure au maroquin.
Chaîne
Succession d’anneaux (mailles) assemblés, obtenus d’abord par martelage, puis mécaniquement au xixe siècle.
Chaîne figaro : mailles ovales allongées. Cet emmaillement est souvent utilisé pour les chaînes de montre.
Chaîne forçat : mailles ovales en fil rond épais, parfois limées. Ce type d’emmaillement très ancien est inspiré des chaînes que portaient les galériens.
Chaîne gourmette : mailles rondes ou ovales vrillées sur elles-mêmes.
Chaîne jaseron : petites mailles rondes enchaînées perpendiculairement les unes aux autres. Ces mailles étaient plutôt utilisées pour les chaînes de cou. Le mot « jaseron », ou anciennement « jaseran », dérive de « al-Djazaïr » (Alger, Algérie), d’où provenaient, au Moyen Âge, les cottes de mailles.
Chaîne palmier : mailles vrillées une fois à droite une fois à gauche représentant deux gourmettes enlacées l’une dans l’autre.
Charivari
Nom donné sous le Directoire aux breloques attachées à la montre, à cause du bruit provoqué par l’entrechoquement.
Châtelaine
Ornement de ceinture formé d’une ou plusieurs plaques décorées auxquelles étaient rattachées une ou plusieurs chaînes servant à suspendre des breloques, des clefs, des ciseaux, une montre… (voir schéma). Une agrafe – ou crochet – en forme de spatule fixée au dos de la première plaque servait à l’accrocher à la ceinture. L’ancêtre de la châtelaine est le « clavandier » porté par les femmes de la noblesse à la période médiévale. D’usage courant au xviiie siècle, la châtelaine disparaît avec les robes sans ceinture sous l’Empire, mais réapparaît à partir de la Restauration.
Chaton
Partie centrale de la bague.
Chute
Ensemble de pierres articulées suspendues à un bijou. Sur un collier : perles disposées en ordre de taille décroissante
Ciselure
Délicat décor que l’on réalise en surface d’un métal avec un outil nommé ciselet. Les motifs sont obtenus sans enlèvement de métal.
Clinquant
Voir à Paillon.
Collier
de chien : généralement en velours portant un motif de joaillerie, il enserre le cou.
esclavage : à plusieurs médaillons (généralement trois) réunis par un ensemble de chaînes à mailles fantaisie ou jaseron dessinant des festons. Bien que déjà mentionné dans des lettres du xviie siècle, c’est sous l’Empire que l’usage de ce type de collier se répand. Il devient ainsi, au xixe siècle, le collier de mariage traditionnel de plusieurs provinces françaises, et donc la marque de l’assujettissement de la femme.
plastron : constitué de plusieurs rangs dégradés et couvrant le haut du décolleté comme un plastron.
rivière : collier souple composé d’une seule variété de pierres, alignées, et dont la monture est très discrète.
sautoir : long collier pouvant descendre sous la poitrine ou jusqu’à la ceinture. Il peut s’enfiler par la tête et n’a pas besoin de fermoir.
Coq
Voir à Montre.
Coquille
Voir à Bouton.
Corail
Longtemps considérés de nature végétale, les coraux sont d’origine animale. Ont peut en pêcher le long des côtes méditerranéennes. Leur couleur va du rouge sang au blanc ; le corail blanc, aussi dit albinos, est plus rare, donc plus recherché. Le corail était déjà pêché dans l’Antiquité : il était prisé pour sa forme et pour sa couleur sang, et on lui assigna de nombreuses vertus et un rôle prophylactique. C’est aussi un matériau de prédilection pour les amulettes. Il fut très à la mode entre 1830 et 1860, notamment gravé en camée.
Coulant
Élément décoratif qui surmonte la chaîne, le cordon ou le ruban au-dessus d’une croix ou d’un pendentif : il permet d’en ajuster la hauteur et le retient de se retourner.
Créoles
Croix Jeannette
Croix latine à motif central et aux bras terminés par un renflement. L’origine du nom remonte au xviiie siècle. C’était une croix paysanne offerte aux servantes le jour de la Saint-Jean.
Cristal
Verre contenant au moins 24% d’oxyde de plomb, ce qui lui confère un éclat brillant, dû à un indice de réfraction plus élevé que celui du verre ordinaire. Le cristal est utilisé pour confectionner des pierres d’imitations. Pour approcher l’éclat et les couleurs des pierres précieuses ou fines, il est coloré au moyen de divers oxydes et souvent paré d’un paillon. Ces pierres d’imitations ont été popularisées à partir de 1746 par le par le joaillier strasbourgeois Georges Frédéric Strass à partir de 1746, dont elles ont pris le nom. De nos jours, la bijouterie fausse emploie fréquemment une variété de cristal commercialisée sous le nom de marque Swarovski.
Cristal de roche
Variété de quartz incolore et transparent parfois utilisée à la place du diamant.
Culasse
Partie inférieure d’une pierre taillée en biseau.
Diamant
La plus dure des pierres précieuses. Son nom vient du grec « adamas » (qu’on ne peut dompter, ni briser). Cette gemme est réputée pour sa pureté et son éclat dès l’Antiquité. Au xviiie siècle, le Brésil devint une nouvelle source d’approvisionnement, vers laquelle se tourna le marché européen. De l’Antiquité jusqu’au xive siècle, le diamant est simplement poli. Puis l’art de la taille du diamant en un nombre croissant de facettes se développe et se répand.Voir à Taille des pierres.
Diamants de la Couronne
Nom donné à l’ensemble des bijoux et des pierres rares initialement réunis par François Ier. Ce trésor fut ensuite enrichi par certains de ses successeurs – ce fut le cas de Napoléon Ier –, tandis que d’autres y ont plutôt puisé. En 1887, pour la première fois, l’État aliéna ce trésor lors d’une vente mémorable où fut dispersée la majorité des joyaux.
Dormeuse
Dorure, argenture
Application d’or ou d’argent sur un objet. Dorure ou argenture à la feuille : technique très ancienne consistant à recouvrir un support d’une feuille d’or ou d’argent très mince obtenue par martelage.
Dorure au mercure : l’or est dissous dans du mercure. Très nocive pour les doreurs, la dorure au mercure est remplacée au milieu du xixe siècle par la dorure par galvanoplastie.
Dorure ou argenture par galvanoplastie : procédé permettant d’obtenir une dorure ou une argenture par électrolyse. L’objet à dorer ou argenter est immergé dans un bain de sel d’or ou d’argent. Le principe de la galvanoplastie fut breveté en 1840. L’industriel français Charles Christofle acheta le brevet, développa le procédé avec son neveu et, en 1842, en diffusa les produits dans la maison d’orfèvrerie qui porte son nom.
Doublé / Plaqué
Technique permettant de donner à un métal non précieux l’aspect de l’or ou de l’argent. Une feuille de métal précieux est posée sur une plaque d’un autre métal (généralement du cuivre ou du laiton) ; ensuite l’ensemble est soumis à une forte pression à chaud, puis laminé. Cette technique fut mise au point par un coutelier anglais en 1742. En France, elle fut autorisée par le roi en 1769 et mise en œuvre dès l’année suivante dans une manufacture royale créée à cet effet.
Émail
Substance vitreuse opaque ou transparente que l’on obtient par fusion à chaud de sable siliceux additionné de divers oxydes qui lui confèrent une large gamme de couleurs. Elle est employée en bijouterie pour recouvrir, colorer, décorer ou donner de l’éclat à des métaux (or, argent, cuivre).
Émail peint ou peinture à l’émail
Peinture sur or ou sur cuivre utilisant des couleurs vitrifiables en poudre appliquées au pinceau. Chaque teinte du motif est posée séparément, puis laissée à sécher et cuite. Il y a donc autant de passage au four que de couleurs. Cette technique, pratiquée à Limoges à partir de la fin du xve siècle, est utilisée en bijouterie sur de petites pièces, telles que boutons, médaillons, épingles, boîtes et cadrans de montre.
Émeraude (taille)
Esclavage
Voir à Collier.
Estampage
Façonnage d’une feuille de métal par déformation plastique à l’aide d’une matrice portant le motif que l’on veut empreindre. L’estampage est l’une des six grandes techniques de travail du métal, avec le repoussé, la gravure, le poinçonné, la ciselure et le découpage à jour (ou repercé). Au xixe siècle, les bijoux composés de plusieurs parties estampées et assemblées se répandirent, car cette technique de production, beaucoup plus rapide qu’avec le travail à la main, permit de mettre sur le marché des pièces creuses légères et bon marché.
Ferronnière
Bijou que les femmes portaient sur leur front, composé d’une fine chaîne ou d’un bandeau passant sur les cheveux et, en son centre, d’une pierre fine ou précieuse. Cette parure était à la mode sous la Restauration, en rappel des portraits de la Renaissance, en particulier celui de la Belle Ferronnière, célèbre tableau de Léonard de Vinci conservé au Louvre. Le joyau central était fréquemment un camée.
Filigrane
Fil métallique lisse, strié, graineté ou multiple, qui est étiré, tourné et soudé pour composer des motifs qui peuvent être soit assemblés entre eux pour composer un bijou entièrement ajouré, soit appliqués sur un objet pour lui servir de décor. La technique du filigrane est utilisée couramment depuis l’Antiquité. Les motifs en filigrane sont souvent ornés de grènetis (granulations).
Fixation (systèmes de)
Boucles et pendants d’oreilles anciens
– Crochet : se passe de l’arrière vers l’avant ; la tige arrondie se fixe au sommet de la boucle.
– Bascule : se ferme de l’arrière vers l’avant ; deux tiges s’articulent et se ferment derrière le lobe de l’oreille.
– À l’italienne ou col de cygne : se passe de l’avant vers l’arrière, sans sécurité.
Boucles et pendants d’oreilles modernes
– Clip : système de pince
– Vis : molette de serrage sur tige filetée (système appelé frou–frou).
Broches
– Crochet simple : l’épingle est engagée dans le crochet.
– Crochet à pompe : l’épingle est engagée dans un petit crochet en forme de tube et muni d’une sécurité.
Colliers et bracelets
– Fermoir à clavier : fermoirs en T, où l’on passe un bâtonnet dans un cercle.
– Fermoir à plaque cadenas : système de fixation d’un collier identique au fermoir à cliquet du bracelet, mais dont la plaque est plus large.
– Fermoir à cliquet : un cliquet formant ressort se glisse dans la fente ménagée dans le boîtier, généralement orné, constituant l’autre partie du fermoir de bracelet.
Boutons de manchettes
– À double effet : les patins, de forme plate, sont basculants.
Fonte de Berlin
Les bijoux en fer fondu furent fabriqués à Berlin à partir de 1806 au moment de l’envahissement de la Prusse par Napoléon. Les Prussiennes furent alors incitées à offrir à leur patrie leurs bijoux précieux pour contribuer à l’effort de guerre. Elles reçurent en remplacement ces pièces, moulées en fonte de fer. Ces bijoux inhabituels devinrent rapidement une mode et furent ensuite fabriqués dans d’autres pays d’Europe. De couleur sombre et d’aspect mat, ils constituaient de parfaits bijoux de deuil.
Fusée
Partie de la poignée d’une épée comprise entre la garde et le pommeau.
Gemme
Terme utilisé aujourd’hui pour désigner l’ensemble des pierres dures, fines et précieuses.
Glyptique
Art de la gravure des pierres, soit en creux (intaille), soit en relief (camée).
Granulation
Voir à Grènetis.
Gravure
Travail d’incision ou de creusement à l’aide d’instruments tranchants qui s’accompagne de l’enlèvement de fragments de matière, contrairement à la ciselure.
Grènetis
Décor par apport de métal ayant l’aspect de granulations, obtenus par apport de métal en fusion sous forme de gouttes. Souvent utilisé conjointement avec la cannetille et le filigrane, le grènetis est d’emploi courant à partir de la Restauration.
Intaille
Gravure en creux sur une pierre dure ou du verre, à l’opposé des camées qui sont gravés en relief. Les intailles sont le plus souvent utilisées pour les armoiries, les sceaux et les cachets, mais peuvent aussi être présentées seules ou montées en bijou.
Jais
Le jais provient de plantes qui se sont lentement fossilisées dans le sol. Il peut être poli et taillé, sa couleur noire étant rendue brillante par le facettage et le polissage. Les bijoux en jais étaient ceux du deuil. Ils furent mis à la mode à la cour de la reine Victoria, en Angleterre, premier pays producteur de jais, et leur usage est resté courant jusqu’à la fin du xixe siècle.
Joaillerie
Art de monter en bijoux des pierres fines et précieuses en mettant en valeur leur taille, leur couleur, leur éclat. Ce métier manuel demande un grand savoir-faire. Ce terme est aussi utilisé pour désigner l’atelier et le magasin du joaillier.
Jonc, demi-jonc
Tige de métal de grosseur uniforme sur toute sa longueur qui donne son nom à un type de bracelet et de bague. Elle peut être fermée (par exemple pour former une alliance), ouverte (comme l’est un torque), ou munie d’une charnière et d’un fermoir (pour un bracelet). Sa section peut être ronde, demi-ronde, ovale, carrée ou fantaisie. Les joncs peuvent être ciselés, torsadés, émaillés, sertis de gemmes…
Listel
Petit filet en saillie qui se combine à un filet en creux dans les boucles de chaussure.
Maroquin
Peau de chèvre tannée au moyen de produits végétaux.
Marquise
Voir à Bague marquise et à Taille des pierres : marquise.
Memento mori
Bijou (généralement des bagues) portant la représentation d’un crâne ou d’un squelette. Il tire son nom d’une locution latine signifiant « souviens-toi que tu mourras ». Ce type de bijou a été mis à la mode à la Renaissance.
Micromosaïque
Technique héritée de l’Antiquité qui consiste à réunir puis à coller de très petits fragments de verre teinté ou de pierres dures pour créer un motif. Sous l’Empire, beaucoup de plaques en micromosaïques destinées à être montées en bijoux étaient réalisées à Rome, qui devint au xixe siècle le centre d’une production touristique. Florence était spécialisée dans la mosaïque de pierres dures (pietre dure) et Rome dans celle de pâtes de verre (tesserae).
Miniature
Peinture de petites dimensions exécutée avec finesse. Les miniatures sont souvent réalisées sur des supports précieux comme le vélin, l’ivoire, la porcelaine, la nacre, l’émail, le métal…
Montre
Boîte de montre, ou boîtier : Élément servant à protéger le mouvement de la montre contre la poussière, l’humidité et les chocs. Sa face externe est le support de décors qui ont varié selon les époques, les modes et le goût des acheteurs.
Coq : Plaque servant à recouvrir et protéger le balancier de certaines montres. Elle est, le plus souvent, de forme ronde ou ovale. Le coq apparaît au xvie siècle et est initialement très simple. Ceux du xviiie siècle sont, eux, souvent richement décorés : gravés, ajourés et repercés, à motifs végétaux, animaux, petites scènes à figures humaines, etc. On les retrouve par la suite montés en broche, en épingle de cravate…
Cuvette : Double fond du boîtier, chargé d’améliorer la protection contre les poussières. Il est souvent gravé d’inscriptions ou de la signature.
Échappement : Mécanisme qui sert à régulariser le mouvement d’une montre, en interrompant à intervalles réguliers le mouvement des roues et distribuant périodiquement l’énergie au balancier. Le système le plus ancien est l’échappement à verge (aussi dit « à roue de rencontre »). Bien qu’utilisé jusqu’au milieu du xixe siècle, il est remplacé progressivement par l’échappement à ancre, inventé en 1680, puis par celui à cylindre, inventé en 1720, qui permit de construire des montres plates.
Montre à répétition : Montre dotée d’un mécanisme de marteaux frappant un gong ou une cloche pour indiquer de façon sonore les heures, les quarts d’heure et les minutes.
Montre à tact : Montre inventée en 1799 par Abraham Louis Breguet pour permettre de lire l’heure au toucher, grâce à la fixation renforcée des aiguilles et aux petites protubérances qui parsèment le cadran. Ces montres très utiles aux aveugles permettaient aussi de lire l’heure dans l’obscurité.
Montre à toc : Montre de gousset qui indique l’heure au moyen d’un mécanisme produisant un son étouffé, engendré par des marteaux frappant sur la boîte de la montre. Ce son est peu audible mais se ressent quand on tient la montre en main. Les montres à toc permettaient de connaître l’heure sans déranger les personnes se tenant à proximité.
Montre turque : Montre à double boîtier très ornée, portant sur le cadran des chiffres en caractère turcs. Les horlogers anglais en réalisèrent à partir du xviiie siècle pour le marché turc.
Pendant : Élément vertical qui relie le boîtier et l’anneau d’une montre. Il porte souvent les poinçons de garantie. Le remontoir qui coiffe le pendant à la fin du xixe siècle est absent des montres étudiées dans ce corpus.
Pendule et montre sympathiques : Ensemble inventé en 1795 par Abraham Louis Breguet et composé d’une pendule et d’une montre qui, placée dans un creux de celle-ci, se trouve automatiquement remise à l’heure et réglée. Le mot « sympathique » a été choisi pour exprimer l’entente et l’harmonie.
Platine : Partie arrière du mouvement. Elle porte souvent la signature de l’horloger et son adresse.
Nœud à la Sévigné
Grand nœud symétrique à plusieurs boucles. Aux xviie et xviiie siècles, la mode fut aux broches ou pendants d’oreilles en forme de nœud de ruban supportant des petits pendants, dont l’origine est la coiffure de la marquise de Sévigné (1626-1696).
Opaline
Verre à fines inclusions imitant les reflets de l’opale.
Ors de couleur
La couleur de l’or peut être nuancée selon la nature et la proportion des métaux entrant dans ses alliages : l’or rouge s’obtient avec du cuivre, l’or vert avec de l’argent, l’or blanc avec du nickel (aujourd’hui interdit et remplacé par du rhodium), l’or rose avec un mélange de cuivre et de nickel ou d’argent.
Paillon
En bijouterie, c’est une feuille de métal colorée ou non qui, placée sous une pierre, en augmente l’éclat.
Pampilles
Nom donné aux petites pendeloques effilées, fréquemment de taille irrégulière, qui terminent une broche ou des pendants d’oreilles.
Pendant
Bijou ou élément d’un bijou monté en suspension. Les pendants sont souvent utilisés symétriquement.
Pendant d’oreille : voir à Boucles et pendants d’oreilles.
Élément d’une montre : voir à Montre
Pendeloque
Élément décoratif articulé suspendu à un bijou souvent en forme de goutte ou de poire.
Pendentif
Bijou que l’on suspend à un cordon, un lien, une chaîne, un bracelet ou un collier, généralement au moyen d’une bélière. On peut porter en pendentif un médaillon, un porte-bonheur, une amulette…
Perle
Concrétion composée de fines couches concentriques de nacre provenant généralement des huîtres perlières.
Perle baroque : de forme irrégulière. L’emploi des perles baroques est l’une des caractéristiques de la joaillerie Renaissance.
Perle fine : naturelle, elle s’est formée sans intervention de l’homme.
Perle de culture : sa formation est due à l’introduction par l’homme d’un greffon dans le coquillage d’un mollusque.
Semence de perle : de très petite taille. Les semences de perle sont utilisées pour former sur les bijoux des motifs géométriques.
Pierre
D’imitation : les pierres précieuses, les pierres fines et le jais peuvent être imités avec du verre ou du cristal coloré au moyen d’oxydes métalliques. Voir à Cristal.
Dure : gemme caractérisée par sa dureté et son opacité, ainsi que la beauté de sa chatoyance, telle l’agate, la calcédoine, le jaspe, le lapis-lazuli, la turquoise…
De lave ou lave du Vésuve : calcite (roche calcaire) de couleur grise ou approchante que l’on trouve aux alentours de Naples.
Fine : pierre dure transparente, telle que l’aigue-marine, l’améthyste, la citrine, le cristal de roche, le grenat, l’opale, le péridot, la topaze… Ces gemmes étaient autrefois appelées commercialement « pierres semi-précieuses », mais ce terme est aujourd’hui illégal.
Précieuse : pierre parmi les plus rares par sa transparence, sa dureté, sa beauté et son éclat. Depuis 1938, cette appellation est réservée au diamant, à l’émeraude, au rubis et au saphir.
Plaqué
Voir à Doublé.
Platine
Métal qui se trouve dans la nature à l’état natif ou allié. Le platine a été utilisé en joaillerie dans l’Antiquité, mais en a ensuite disparu jusqu’à ce que les Européens le redécouvrent en Colombie au xviiie siècle. Voir aussi à Montre.
Poinçon
Marque apposée sur les pièces d’orfèvrerie pour certifier que le titre du métal a été contrôlé, pour attester le paiement de l’impôt ou comme signature de l’artiste. Voir l'introduction
Poissarde
Repercé ou découpage à jour
Travail long et minutieux de découpe de motifs et ornements réalisé avec une scie à repercer. Le repercé est l’une des six grandes techniques de travail du métal, avec le repoussé, la gravure, le poinçonné, la ciselure et l’estampage.
Repoussé
Très ancienne technique de décor exécutée en repoussant le matériau au revers de l’objet, au moyen d’outils en métal ou en bois dur, jusqu’à obtenir un relief sur la face. Le repoussé est l’une des six grandes techniques de travail du métal, avec le découpage à jour (repercé), la gravure, le poinçonné, la ciselure et l’estampage.
Rinceau
Étymologiquement, le rinceau est un petit rameau. Dans le domaine artistique, ce mot désigne un ornement composé d’éléments végétaux disposés en enroulements successifs.
Rivière
Voir à Collier.
Semence de perle
Voir à Perle.
Sertissage
Le sertissage consiste à fixer les pierres sur les bijoux ou ornements. Il en existe trois grands types qui sont confondus avec la monture : à grains, à griffe et clos.
Serti ou montage à grains : type de sertissage utilisé pour de petites pierres et les pavages. Les pierres peuvent être maintenues par 2 ou 4 grains (les grains sont des copeaux de métal levés et poussés contre la couronne de la pierre de façon à la tenir fermement comme de minuscules griffes). Son défaut est qu’il est relativement facile de perdre une pierre.
Serti ou montage à griffe, ou à jour : il permet de laisser voir la pierre au maximum. Les griffes sont des petites languettes de métal le plus souvent soudées à un anneau nommé ceinture, sur lequel on assoit la pierre avant de rabattre dessus l’extrémité des griffes pour l’enserrer. Cette technique apparaît au début du xixe siècle.
Serti clos ou monture à fond : dans ce type de sertissage, la pierre est placée dans une cavité creusée dans le métal. On laisse initialement ce métal dépasser légèrement de façon à pouvoir le rabattre sur le pourtour de la pierre. Ce sertissage s’use peu. C’est le sertissage le pus ancien et le plus fréquent sur les bijoux étudiés.
Sévigné
Voir à Nœud.
Simili
Pierre imitant généralement le strass, et dont la culasse est recouverte de tain.
Similor
Alliage de métaux imitant l’or qui s’est développé dans la seconde moitié du xixe siècle.
Strass
Voir à Cristal.
Table
Nom donné à la plus grande de toutes les facettes d’une pierre taillée, située sur le dessus, au centre de la pierre.Voir à Taille des pierres : Émeraude
Taille des pierres
Elle a beaucoup évolué au fil des siècles.
Émeraude : taille en table utilisée à la Renaissance, le plus souvent pour l’émeraude, une des pierres alors les plus répandues.
Rose : taille ancienne, apparue vers 1520. La partie supérieure est facettée, tandis que le dessous est plat.
Marquise (ou navette) : taille fantaisie ayant la forme de deux arcs de cercle égaux se réunissant en pointe.
Brillant (ou ronde) : taille du diamant mise au point au début du xxe siècle. Elle comporte cinquante-sept facettes. Pour les bijoux anciens, « brillants » désigne des éclats de diamants.
Tissage ou tissu d’or
Fils d’or enchevêtrés et croisés manuellement, comme des fils textiles, pour former un tissu souple. Le tissu d’or a été utilisé pour réaliser des chaînes et des bracelets à partir de la Restauration.
Tissu polonais
Tissu d’or réalisé à l’aide de fils enfilés sur des cannetilles entrecroisées.
Titre
Degré de métal précieux fin entrant dans la composition des alliages d’or, d’argent et de platine. Le titre, défini par la loi, est le rapport entre le poids d’un métal précieux et le poids de son alliage. Il s’évalue en millièmes. De l’or à 750 millièmes contient 750 grammes d’or fin pour 1 000 grammes d’alliage, les 250 grammes restant étant composés d’un ou plusieurs autres métaux.
Trois ors
Voir à Ors de couleur.
Vermeil
Argent recouvert d’une couche d’or plaqué. Le vermeil a été reconnu au xviiie siècle.
Verre églomisé
En bijouterie, verre décoré au revers d’une feuille d’or gravée. Cette technique, déjà connue par les Égyptiens dans l’Antiquité, fut utilisée à la Renaissance et se répandit au xviie siècle. Médaillons et pendants d’oreilles en verre églomisés bordés d’un filet d’or furent à la mode sous le Consulat.
Vinaigrette
Petite boîte recouverte d’une grille articulée qui pouvait, ou non, être incluse dans un bijou. Quand les femmes, au xixe siècle, avaient des « vapeurs » (l’époque était aux corsets extrêmement serrés), elles respiraient le vinaigre aromatique qui imbibait la minuscule éponge que recelait la vinaigrette.
Volute
Enroulement en spirale.